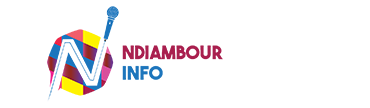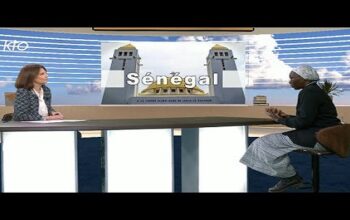Dr Saliou Dramé, essayiste et DG du cabinet immobilier IMMOSEN.
Tandis que les discours sur l’émergence économique se multiplient, un modèle de développement hérité de la colonisation persiste, sournois et contre-productif : l’hypertrophie des capitales.
Dakar, vitrine d’un Sénégal dynamique, suffoque sous le poids de ses propres succès. Sa congestion, son coût de la vie et la concentration extrême des opportunités créent un déséquilibre intenable.
Poursuivre sur cette voie, c’est condamner notre nation à une croissance boiteuse, socialement explosive et fondamentalement fragile. L’alternative ? Opérer une révolution mentale et stratégique : faire de nos territoires le nouveau front pionnier de la prospérité sénégalaise. Nous n’en dirons jamais assez.
Le penseur sénégalais Felwine Sarr, dans son manifeste Afrotopia, nous exhorte à « désapprendre » les modèles importés pour inventer les nôtres. S’obstiner à tout construire autour de Dakar, c’est reproduire un schéma centralisateur qui n’est ni une fatalité, ni une nécessité.
Le visionnaire Cheikh Anta Diop, dans Les Fondements économiques et culturels d’un État fédéral d’Afrique noire, plaidait déjà pour un développement endogène et décentralisé, ancré dans les réalités et les potentiels locaux. Son héritage intellectuel est un appel à libérer les énergies de nos régions.
Nous devons donc lancer un projet national audacieux : la création de « Pôles de compétitivité régionaux ». Il ne s’agit pas d’un simple plan de décentralisation, mais d’une stratégie agressive de spécialisation intelligente. Imaginez :
-La Casamance transformée en une vallée de l’agro-écologie et de l’écotourisme, attirant des investissements dans la transformation bio de ses fruits tropicaux et une hôtellerie de luxe durable.
-Le Bassin arachidier réinventé en hub de la logistique et de la transformation agro-alimentaire, avec des zones franches dédiées aux industries de conditionnement et des plateformes logistiques connectées au port de Dakar.
-La zone de Saint-Louis devenant un pôle créatif et numérique, capitalisant sur son patrimoine et son université pour attirer des data centers et des entreprises de tech fuyant la surchauffe dakaroise.
-Le Sénégal Oriental se mua en champion de l’énergie solaire et de l’élevage moderne, où des centrales photovoltaïques alimentent des unités de production laitière et de viande réfrigérée.
Cette vision n’a rien d’une utopie. L’économiste britannique Paul Collier, dans Le Bottom de Milliard, a montré que les pays pauvres échouent souvent à décoller à cause du « piège du retard ». Briser ce piège requiert des investissements publics ciblés dans les infrastructures pour « amorcer la pompe » du secteur privé. C’est le rôle de l’État de créer les conditions de la rentabilité privée en dehors de la capitale : routes, énergie fiable, fibre optique, et parcs industriels clés en main.
Les travaux de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala sur les réformes soulignent l’importance de la gouvernance. Ces pôles régionaux devront être gérés par des agences publiques-privées agiles, bénéficiant d’une autonomie de gestion et d’un « choc de simplification » réglementaire pour attirer les investisseurs.
Pourquoi ne pas créer des statuts fiscaux incitatifs, une justice commerciale accélérée et des guichets uniques dans ces zones, faisant de chaque pôle une « vitrine » des réformes du Sénégal ?
Enfin, cette politique est une réponse puissante aux défis de notre siècle. L’urbaniste Mike Davis, dans son livre choc Le Pire des mondes possibles, a décrit l’explosion des bidonvilles comme la conséquence d’une urbanisation sauvage et non planifiée. En offrant un avenir économique dans les territoires, nous luttons contre l’exode rural et la pression urbaine insoutenable.
Nous construisons un développement plus résilient, plus humain, et plus durable.
La question n’est plus de savoir si nous pouvons nous permettre de lancer cette révolution des territoires. La question est de savoir si nous pouvons nous permettre de ne pas le faire.
Le Sénégal de 2035 sera soit un pays diversifié, équilibré et fort de la richesse de toutes ses régions, soit une capitale étouffante entourée de déserts économiques. Le choix est entre la vision de Cheikh Anta Diop et le statu quo. Faisons le bon choix. Investissons dans la géographie de notre avenir.
Bibliographie :
Sarr, F. (2016). Afrotopia. Éditions Philippe Rey.
Diop, C. A. (1974). Les Fondements économiques et culturels d’un État fédéral d’Afrique noire. Présence Africaine.
Collier, P. (2007). Le Bottom de Milliard : Pourquoi les pays pauvres ne décollent-ils pas ?. Éditions Autrement.
Okonjo-Iweala, N. (2012). Reforming the Unreformable: Lessons from Nigeria. MIT Press.
Davis, M. (2006). Le Pire des mondes possibles : De l’explosion urbaine au bidonville planétaire. Éditions La Découverte.
Lopes, C. (2020). L’Afrique est l’avenir du monde : Repenser le développement. Éditions du Seuil.