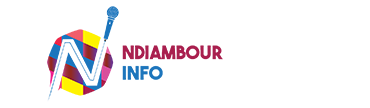Afrique : limites et biais du système de classement Doing Business.
Par Nongo Sylla, chroniqueur
Le rapport DB repose sur une théorie simpliste du développement économique qui est peu pertinente dans le cadre de pays comme les nôtres. L’absence de réaction critique sur ce rapport est l’indicateur le plus probant de l’adhésion des « élites » sénégalaises au « Consensus de Washington », c’est-à-dire au paradigme néolibéral. Car le classement Doing Business n’a rien de « scientifique ». Ce n’est pas non plus un guide pertinent pour la politique économique, surtout dans le contexte des pays les plus pauvres où l’engagement étatique dans la construction économique est crucial. Ce classement est tout au plus un bulletin météo à l’usage du capital étranger.
Commençons par certaines limites méthodologiques que la Banque Mondiale signale elle-même. Pour établir le classement DB, les « données » collectées dans chaque pays sont restreintes d’ordinaire à la ville la plus dynamique sur le plan économique. Elles ne concernent également qu’un type particulier de société (par exemple les sociétés à responsabilité limitée). La notion de « business » ne couvre donc que des entreprises qui par définition ne peuvent être représentatives de la majorité des entreprises opérant dans une économie donnée. De sorte que ce qui s’avère pertinent pour les types d’entreprises sélectionnées par le rapport DB peut ne pas l’être pour le reste.
Venons-en ensuite aux nombreux biais qui ont régulièrement alimenté des critiques sur ce rapport. Il y a un biais anglo-saxon notable reconnu par les concepteurs de l’exercice, biais qui tend à défavoriser les pays influencés par le droit civil français. Un biais anti-pays émergents contribue également à sous-classer des pays comme la Chine, l’Inde ou la Russie. Alors que la Chine est la seconde puissance économique mondiale et l’une des économies les plus dynamiques de ces trois dernières décennies, elle n’arrive que 96e cette année, largement derrière des pays en faillite comme le Portugal, l’Italie, la Grèce et l’Espagne. La Chine plaide d’ailleurs depuis quelque temps pour la suppression de ce rapport. C’est à la suite de ses plaintes et de celles de l’Inde qu’un comité d’évaluation externe du rapport DB fut mis sur pied. Ce panel d’experts dirigé par Trevor Manuel, le ministre sud-africain du Plan, a rendu ses conclusions en juin dernier. Sa recommandation principale est que la Banque Mondiale cesse d’établir un classement international pour l’indicateur « facilité de faire des affaires ». Raison invoquée : ce classement peut donner l’impression fausse qu’un seul type de politiques peut être valable partout(1). Autre biais dénoncé par les syndicalistes et ceux qui luttent contre les paradis fiscaux : le rapport DB tend à classer favorablement les pays qui sont les champions de la libéralisation du marché du travail (moins les travailleurs sont protégés, plus la facilité de faire des affaires est augmentée selon DB) et de la déréglementation fiscale (moins les entreprises, notamment les multinationales, paient d’impôts, plus la facilité de faire des affaires est augmentée selon DB).
D’un point de vue théorique, DB repose sur l’hypothèse que plus l’économie est déréglementée, mieux elle se porte. Si cela avait été le cas, si la déréglementation de l’environnement des affaires était la clé du progrès économique, la Corée du Sud serait toujours restée un pays pauvre au seuil du XXIe siècle. Jusqu’au début des années 1990, il fallait pour démarrer une entreprise obtenir 299 permis délivrés par 199 agences ! Or, entre 1960 et 1990, malgré ce cadre a priori délétère pour les affaires, la Corée du Sud a obtenu en moyenne une croissance du PIB par habitant de 6% par an(2). L’explication est pourtant simple : il n’y a pas de barrières qui puissent freiner ou décourager des entrepreneurs qui ont un projet bon et porteur. Par contre, la « facilité de faire des affaires », autre nom pour décrire l’adoption d’un cadre libéral de désengagement de l’Etat, peut encourager des comportements spéculatifs qui privilégient la rentabilité de court-terme au détriment des investissements productifs à long terme, ceux-là mêmes qui peuvent porter une économie vers l’avant.
D’un point de vue empirique, les objectifs les plus importants de la politique économique (la création d’emplois décents, la réduction de la pauvreté, l’égalité et l’équité sociales, la croissance économique) ne semblent pas être corrélés avec la facilité de faire des affaires telle que mesurée par le classement DB. Ce qui n’est pas une surprise car le rapport DB s’intéresse à la nature des régulations, beaucoup moins à leurs conséquences réelles(3).
Quand il s’agit de prédire les pays africains qui ont la préférence du capital étranger, le classement DB est également un indicateur très limité. Durant cette dernière décennie, des pays mal classés comme l’Angola, le Nigéria, la Guinée Equatoriale et la République Démocratique du Congo, pays qui sont de surcroît réputés corrompus, ont attiré plus d’Investissements Directs Etrangers que la plupart des bons élèves africains du classement DB. Ici également l’explication est simple : la perspective de pouvoir réaliser des profits considérables dans les industries extractives est suffisamment incitative pour le capital étranger (de plus en plus non-occidental) qui parvient à s’acclimater, moyennant parfois le recours à la corruption.
Tout ceci pour dire que le Rapport DB repose sur une théorie simpliste du développement économique qui est peu pertinente dans le cadre de pays comme les nôtres qui ont besoin justement de construire patiemment de nouvelles capacités productives dans des secteurs porteurs sur le long terme. Il ne nous permet pas non plus de comprendre les logiques de déploiement de l’investissement étranger dans les pays de la périphérie du système capitaliste. Ceux qui prennent le classement DB comme un guide pour la politique économique ou comme un outil d’évaluation de la pertinence des réformes institutionnelles le font à leurs risques et périls.
Qui vainc par Doing Business périra par Doing Business. Pendant plus d’une décennie on nous aura vendu l’idée que le Sénégal était sur la voie de l’ « Emergence », car nous avions le satisfecit de la Banque Mondiale dont les rapports DB constataient nos progrès en termes de réformes institutionnelles. Nous voilà maintenant, nous les apprentis bons élèves, plus démunis que jamais !
Il ne faut pas dormir sur la natte des autres, disait le Professeur Ki-Zerbo, car c’est comme dormir par terre. Il en va des nattes comme des programmes de développement économique. Espérons que nos «élites » sauront retenir la leçon et réorienter l’énergie de nos concitoyens vers des choses et des stratégies plus essentielles pour l’avenir de notre pays.
Ndiambourinfo