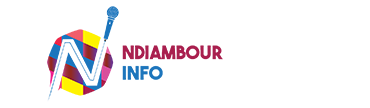“L’université Gaston Berger n’était pas une simple institution : c’était un mythe, une fabrique de grands hommes, un sanctuaire de l’intelligence républicaine. On y venait pour apprendre, mais on y venait surtout pour se mesurer à l’idéal de l’élite. On y entrait avec des certitudes, on en ressortait souvent avec des cicatrices. J’y ai entamé une formation exigeante en droit public, attiré par les grandes questions d’État, de pouvoir, de légalité. Mais très vite, le rêve s’est effrité : la maladie, les désillusions amoureuses, les échecs sans nom, et cette solitude nue qui colle à la peau des jeunes déracinés. La vie étudiante n’avait rien de romantique. C’était une épreuve sèche, brutale, anonyme. Mais dans cette rudesse, j’ai appris à tenir tête, à me rebeller, à faire face à la concurrence et à l’émulation intellectuelle. À Saint-Louis, on n’attendait pas qu’on vous tende la main. Il fallait parler fort, réfléchir vite, marcher droit. J’ai mis du temps à entrer dans ce bain bouillant. Pendant que d’autres brillaient naturellement, moi j’avançais à tâtons, un pied dans l’amphi, l’autre dans mes incertitudes. Mais à force d’endurance, j’ai fini par décrocher mon diplôme universitaire, sans jamais être convaincu que j’étais fait pour le droit.
Certains enseignants me voyaient pourtant chercheur inné, penseur méthodique, esprit d’analyse prometteur. Mais pendant qu’ils me dessinaient un avenir dans la recherche ou l’enseignement supérieur, je rêvais d’autres horizons. Le droit m’avait donné des armes, mais pas encore de mission. C’est peut-être là que j’ai compris que la connaissance seule ne suffit pas : il lui faut un cap, une direction, un but — un viatique. Et dans ce vacillement, quelques figures sont devenues des points d’ancrage : Assane Seck, Cheikh Diop, Yahya Abou Guiro, Ibrahima Niang, Papis Diarra, Malick Pam, Mady Sy. Avec eux, j’ai compris que l’université n’était pas qu’un lieu de savoirs : c’était un creuset d’humanité.
Mais Sanar, ce n’était pas que l’université et ses cours. Sanar était beau. Il y avait le foot, les terrains sablonneux où je me faisais remarquer comme un joueur rugueux, technique, mais terriblement indiscipliné. Gravesen, on me surnommait. Pas seulement pour le sang chaud du Lébou, prompt à l’emportement, mais aussi pour ma capacité à porter l’équipe, à donner de ma personne, à faire bloc dans l’adversité. Je menais au score comme on mène à la guerre : sans calcul, avec panache. Un week-end, resté célèbre dans ma mémoire comme dans celle des bancs de touche, je reçus trois cartons rouges dans trois compétitions différentes. Un triptyque d’exclusion, en à peine quarante-huit heures. Cela en disait long. Non pas seulement sur ma fougue, mais sur cette part en moi encore en friche, qui cherchait à canaliser la force sans la mutiler.
Sanar, c’était aussi les tickets rouges et bleus, sésames fragiles pour les repas et les petits déjeuners, que je perdais ou oubliais souvent. Je n’ai jamais été un maître en gestion budgétaire. L’argent me filait entre les doigts comme un ballon trop léger. J’apprenais à survivre entre malice, honte et solidarité. Chaque fin de semaine était un exercice d’équilibriste entre dignité et débrouille.
Le Village K, c’était notre repaire. Un bout de territoire marginal mais chargé de sens, au sein d’un campus en mutation. Officiellement, c’était une zone réservée aux étudiants de troisième cycle. Progressivement, c’est devenu un quartier chaud, là où se cristallisaient les tensions, les dérives, les rêves et les postures. En vérité, Sanar n’était plus Sanar : le campus social devenait autre chose. Et le Village K en était le laboratoire vivant. Il y avait de tout, comme dans une fresque sociologique grandeur nature : les reggaemen aux yeux rougis et aux maximes d’Éthiopie, les thugs tapageurs, les étudiants tirés au cordeau avec chemises repassées, pantalons bien brayés, chaussures cirées comme pour une soutenance permanente. Il y avait les filles voilées, discrètes, pieuses, et d’autres qui revendiquaient bruyamment leur droit à l’excentricité. Il y avait les sages et les exubérantes, les effacés et les flamboyants. Les soufis, les salafis, les traditionalistes malékites, les athées tranquilles, et une masse de non-alignés qui naviguaient au gré des vents.
La mosquée elle-même, si modeste, n’échappait pas à cette effervescence. Elle servait bien sûr de lieu de prière, mais aussi de tribune, de théâtre, parfois même de champ de bataille. Ce n’est pas exagéré de dire que Sanar peut être un lieu de radicalisation. Comme en prison, certains esprits s’y ferment autant qu’ils s’y révèlent. J’ai vu de mes propres yeux des amis, brillants et drôles, soudain métamorphosés : un matin, ils échangeaient jeans délavés et tee-shirts humoristiques contre une jellâba sobre, un pantacourt scrupuleusement ajusté et des baskets sans marque. Ils s’étaient « réveillés », disaient-ils. Et leur réveil, hélas, était souvent bruyant. Certains prenaient ce tournant avec noblesse, avec une gravité douce qui forçait le respect. Mais d’autres – et c’étaient les plus bruyants – se mettaient à vouloir réformer le monde en quarante-huit heures, oubliant que même Dieu a pris six jours pour créer les cieux et la terre. Leur zèle se muait en intransigeance, puis en intolérance. La wazifa du matin devenait un champ de tension : un jour, l’un d’eux a voulu interdire notre méditation, invoquant la bidʿa. Un autre, sans vergogne, a piétiné le drap blanc sur lequel on s’asseyait pour nos oraisons. À deux doigts de l’altercation physique. Et tout cela pour quoi ? Pour une mosquée de fortune, de trente mètres carrés à peine. Chaque groupe voulait imposer son imam. Les soufis présentaient leur hafiz, les salafistes brandissaient le leur, les traditionalistes cherchaient un consensus introuvable. Un jour, on a même organisé une sorte de concours – que dis-je, une audition – pour départager les récitateurs. Comme si cette modeste mosquée abritait les clés du califat universel.
Oui, Sanar est une fabrique d’élites. Mais c’est aussi, parfois, une fabrique d’intégristes. Il ne sert à rien de le nier. Dans les couloirs du savoir, certains s’égarent. L’intelligence, quand elle n’est pas domptée par la mesure, devient une arme retournée contre soi. Et la foi, lorsqu’elle est vidée de l’humilité, se transforme en théâtre d’ombres.”
EXtrait de Koukoy, mon prochain ouvrage.
Ndiambourinfo